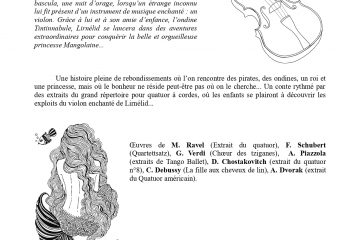Sommets montagneux, mer houleuse, cité resplendissante et îles mystérieuses… L’odyssée périlleuse du jeune Raphaël amène le lecteur aux confins du monde taramand, au sein d’une nature toujours changeante, rebelle, infiniment dangereuse et séduisante.
Le massif montagneux d’Antalay, le plus jeune du monde connu, semblait veiller sur l’ensemble du continent du haut de sa sagesse millénaire ; pourtant, ses sommets gigantesques, ses arêtes et ses vallées poétiques participaient de cette vie déferlante, commune à l’ensemble des manifestations de la nature. Grandioses, rayonnantes d’une beauté à la fois terrible et magique, ses crêtes inaccessibles scintillaient avec orgueil quand le soleil les caressait de ses rayons ; elles devenaient au contraire graves, pensives et mélancoliques lorsque le pâle arc lunaire se levait pour allumer les étoiles.
Du haut de sa montagne, Raphaël tente d’imaginer la mer, qu’il n’a encore jamais vue :
Une mer n’est pas un lac sans rivage. La mer possède des rives. Des dizaines et peut-être des centaines de rives. La mer possède des vagues. De grandes et larges vagues roulantes d’écume. La mer possède les terres qu’elle entoure et embrasse. La mer nous encercle.
Pandore, la visionnaire, imagine la mer en songe ; mais une mer furieuse, déchaînée, mortelle. Celle qui vint à bout de l’Atlantide :
La ville entière s’était emplie d’eau. De la terre, on ne voyait plus le ciel qu’au travers d’immenses vagues. Les gens couraient ici et là, paniqués. Le grand palais, d’ordinaire imposant, se faisait alors humble sous la fureur de l’océan. Les femmes et les hommes étaient balayés comme des fourmis dans un ruisseau ; leurs forces jointes n’étaient pas assez puissantes pour lutter contre l’emportement des flots. D’ailleurs, s’ils avaient pu résister, avancer, qu’auraient-ils fait ? Où seraient-ils allés ? Les seuls qui dormaient en paix étaient les cadavres que le courant emportait déjà. […] Tout devint flou quand les cloches du temple se mirent à sonner, sonner, comme pour avertir le monde entier que l’île agonisait. Elles ne cessèrent pas de carillonner quand la mer les engloutit, dans un dernier élan. Elles sonnaient encore sous l’eau, elles doivent sonner encore. Soudain, le soleil baigna la mer de son rayon matinal et ce fut l’aurore qui me réveilla.
L’Atlantide est morte. Mais l’île Hécate règne sur les flots, plus puissante que jamais :
Ce pays embrassé par la mer, cette terre fertile aux saveurs si variées, aux arômes multiples, avec ses pâturages immenses, ses grandes étendues, son relief soudain qui permet au regard de s’étendre au loin, les vagues argentées qui lèchent les calanques aux pieds du palais de roche, élevé en pleine nature par les humains d’un autre âge.
Et l’île Hécate est le fief de la petite Sapho, fille de la reine Victoria et d’Ilya de Lendoliov. Elle y est née et l’île fait partie intégrante d’elle-même, comme elle fait partie de l’île dont elle tire sa force et sa sève :
Quand le vent marin caresse mon visage et que la nature que j’affectionne s’épanouit autour de moi, je ressens le moindre frémissement de l’air ; je reconnais le son du moindre lézard qui se faufile le long de ce rocher. Je suis de l’humeur de ce ciel d’azur et de l’inclinaison particulière des rayons de ce soleil sur le sol d’Hécate.
La nature est vivante, emplie de déesses, avant que la civilisation ne s’affranchisse de la superstition. Aussi, la nature se manifeste parfois d’une manière incompréhensible :
Droit devant elles, juste sous leurs yeux, se produisait un phénomène étrange. Une nuée trouble s’amassait, comme bloquée par la colline, que le vent pourtant vif provenant de la mer ne parvenait pas à dissiper. Ce cercle de brouillard ondulait lentement et régulièrement sur lui-même, diaphane et impénétrable.
Pourtant, la nature ne s’apprivoise qu’en apparence. L’heure n’est pas venue pour l’homme de la soumettre, comme le dit ce poème très ancien, extrait des
Stances à l’Insomniaque :
Je suis la Nature indestructible et vaillante
Qui jamais aura raison de moi ?
Mais la Nature aidera à la résistance contre l’obscurantisme, et depuis les grottes de la petite île de Libella s’organiseront des activités secrètes et ambitieuses :
Du haut de la caverne s’écoulait une onde claire, brillante, qui tombait en cascade le long de la falaise. En escaladant les parois rocheuses et se faufilant à travers la mince ouverture d’où perçaient les rayons solaires, Sapho découvrit une sorte de piscine naturelle formée par la source qui dévalait d’un plus haut bloc. Cet ensemble féerique était couvert d’une végétation luxuriante qui laissait pointer une lumière mystérieuse.
Et plus que jamais, la pensée humaine est insatiable :
La force brute est comme la pierre. La pensée est comme l’eau. L’eau s’infiltre dans la pierre, elle l’érode. Là où pierre se fendille, l’eau se faufile. Elle se transforme s’il le faut. Elle ne disparaît jamais. Et sa première forme l’attend toujours lorsque le cycle se répète…
L’île Cléüse et son château, lieu insolite et mystérieux, est le lieu où la pensée humaine se construit, au sein d’un secret bien gardé :
Elle les fit pénétrer silencieusement dans un jardin qui paraissait abandonné. Au sein de cet espace de verdure, nulle allée sablée, nul ordre, nulle mesure. La végétation semblait y croître sans contrainte. Certains arbres s’élevaient à des hauteurs infinies ; des fleurs sauvages s’épanouissaient par bosquets désordonnés. Une mousse épaisse couvrait de larges pierres évoquant d’anciens bancs ; et l’on devinait partout de ces mystérieuses cachettes faites pour les assassins ou les amoureux.
[…]
Le désordre de la pièce dans laquelle ils venaient de pénétrer s’apparentait à l’anarchie du jardin ; mais ce n’était plus la flore qui s’épanouissait à tord et à travers : dans cette étrange galerie, les arbres étaient des étagères, les fleurs étaient des livres.
Les personnages eux-mêmes sont parfois allégories de la nature et se définissent comme tels. Ainsi, ces deux sœurs des ténèbres qui se ressemblent sans pourtant être semblables :
Il y a cela de différent entre elle et moi qu’elle est le Jour et que je suis la Nuit ; quand bien même nous serions toutes les deux le ciel.
Et quand le malheur semble submerger l’âme, la nature se montre intraitable, balayant les héros de son souffle indifférent :
Raphaël ramait, ramait éperdument au milieu de la tourmente, avec une sorte de rage ; la rage de vivre qui toujours l’habitait, la colère de succomber à l’adversité avant d’avoir pu appréhender le monde, la frustration de n’être qu’un brin de paille emporté par la première tempête. Cette nuit-là, le malheur semblait enfin avoir le dernier mot. Il ne pensait plus, ne voyait plus ; il ne sentait pas l’humidité qui pénétrait ses chairs, la peur qui perçait ses os. Il n’était plus que la chose de l’écume, une marionnette participant à la tourmente océane, avec pour tout visage le masque impénétrable de la nuit.
Pourtant, après la mort vient la renaissance, et la vie s’enrichit de toute la noirceur passée :
Les mortes parlaient dans la tête du jeune homme, y dispensaient leur sagesse.
Peut-on apprivoiser la nature ? Peut-on l’apprivoiser définitivement ? Peut-on faire nôtre, et acquis à notre cause, un monde sauvage, et vivant parce qu’il est sauvage ? L’être humain avec l’animal, la civilisation avec la nature… Ces questions forment un des principaux thèmes du roman :
Il avait toujours aimé les bêtes qui, contrairement aux humains, n’avaient pas appris la fausseté. Mais ce qu’il aimait par-dessus tout, c’était les animaux sauvages, ceux dont on ne pouvait prévoir la réaction ; ceux qui pouvaient d’un instant à l’autre devenir dangereux si vous leur faisiez peur, ou vous sauver la vie si vous aviez eu le bon geste. Toute son enfance, il avait tenté d’apprivoiser les bêtes sauvages. Il y avait parfois réussi. Mais un renard, même apprivoisé, reste toujours un renard. Il pourra vous aimer ; il sera incapable de vivre avec vous.
Car la force même de la nature, comme celle de l’intelligence humaine, est le mouvement :
Depuis qu’il connaissait la mer, cette divinité imprévisible, il ne cessait d’en découvrir les nouvelles formes, qui le remplissaient tour à tour de terreur et d’admiration. Elle était si changeante, pratiquant une métamorphose perpétuelle dans l’or de ses flots, qu’il la voyait toujours différente, tantôt séduisante tantôt macabre. Sa voix même, mêlée aux murmures du vent, était lyrique et caverneuse, profonde et déchaînée.
Nature apprivoisée, nature maltraitée, nature dévoyée parfois ; car les intérêts humains l’affublent de toutes sortes de théories jamais vérifiées :
La nature humaine… C’est un magnifique bouc émissaire. On lui attribue les folies de l’orgueilleux, la cruauté des tyrans, l’oppression des peuples, la scandaleuse appropriation des richesses par une minorité. La nature ne connaît pas la morale ; elle n’a rien inventé de tout cela. Si les sociétés humaines ont jusqu’à présent détourné chaque belle idée pour créer les conditions de l’asservissement des plus pauvres, ce n’est pas une loi de la nature ; c’est le résultat des rapports de domination mis en place par une même caste, depuis la nuit des temps.
Et c’est au cœur de la cité qui deviendra le centre de l’insurrection, que Raphaël pourra trouver le fleuve, et son salut :
L’eau du fleuve était noire, abyssale, animée d’une vie mystérieuse et terrifiante, profonde comme un gouffre et avide comme un trou noir. Elle semblait prête à engloutir tout ce qui errait dans sa colonne vertébrale pour le précipiter dans la mer vorace.
C’est toujours au sein de la tourmente que brille le plus intense bonheur, et au milieu du désert que brille la plus ardente promesse :
C’était une sorte de gigantesque palmeraie, dont les hautes feuilles protégeaient des rayons solaires et du vent désertique d’autres cultures étagées : bananiers, orangers, grenadiers ; et plus bas, maraîchers et céréales. Par-ci par-là avaient été construites quelques habitations rudimentaires en mortier d’argile ; plus loin, au milieu de l’oasis, on distinguait un village de cultivateurs.
La dualité de cette nature farouche se révèle, en miroir de la dualité des personnages qui en procèdent :
L’humidité étouffante qui l’environnait sortait tout droit de son âme exaltée. Cette terre, ces rochers, ces vagues qui déferlaient au pied des pins maritimes, tout cela se confondait en elle, dans sa colère et dans son amour, la sève même de son cœur.
Il était ivre de puissance et de désir, déchaîné de colère et fou de tendresse. Il agissait en fauve et se sentait dieu.
Et c’est ainsi que…
Viendra le temps écarlate
Celui de la lumière et des cerises
Et de l’enfant chantant sur la barricade
J’aime ça :
J’aime chargement…


 De l’œuvre de Ravel, imprégnée de colorations jazz, jusqu’aux tangos de Piazzolla issus de l’Argentine populaire, l’aube du soir nous emporte dans un tourbillon de notes enchantées empreintes de l’atmosphère du nouveau
De l’œuvre de Ravel, imprégnée de colorations jazz, jusqu’aux tangos de Piazzolla issus de l’Argentine populaire, l’aube du soir nous emporte dans un tourbillon de notes enchantées empreintes de l’atmosphère du nouveau 
 Programme :
Programme : Avec le Quatuor Maiakovski :
Avec le Quatuor Maiakovski :

 Qu’est devenu le petit garçon dans la montagne, enfant des amants de l’Atlantide ?
Qu’est devenu le petit garçon dans la montagne, enfant des amants de l’Atlantide ?





 Elsa Triolet disait quelque chose comme : le créateur, ce ne sont pas dans ses personnages qu’on doit le chercher. Ses secrets sont dans sa manière de créer.
Elsa Triolet disait quelque chose comme : le créateur, ce ne sont pas dans ses personnages qu’on doit le chercher. Ses secrets sont dans sa manière de créer.